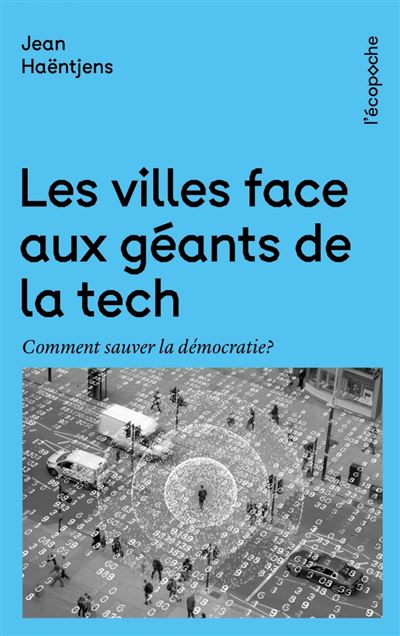Critique : Pour les personnes qui résident en centre-ville, le rapport à notre environnement a bien évidemment évolué en même temps que la société. Les immeubles changent, les capacités technologiques se réorientent pour proposer de nouveaux services et les ajouts plus techniques s’accumulent au fur et à mesure du temps. On peut donc s’interroger légitimement sur ces changements qui impactent directement notre quotidien. C’est pour cela qu’il est intéressant de plonger dans « Les villes face aux géants de la tech », essai de Jean Haëntjens disponible en édition poche chez Rue de l’échiquier.
L’auteur revient ainsi en plusieurs chapitres sur diverses étapes et autres points d’intérêt sur ce sujet assez vaste, avec une approche qui ne devrait néanmoins pas délaisser les personnes moins calées. En effet, la manière d’amener la réflexion pourra diviser par l’absence de parti pris mais mérite d’apporter, par son côté général, des bases qui peuvent servir à orienter et/ou renforcer son opinion. Le tout est court (160 pages) mais permet de brasser rapidement certaines optimisations et évolutions plus ou moins heureuses de façon rapide.
Plus un point de départ pour construire son avis qu’un essai orienté, « Les villes face aux géants de la tech » interroge et réfléchit sur la manière dont se construisent les villes d’aujourd’hui ainsi que leurs diverses variations à l’aube de technologies qui s’intègrent autrement dans notre quotidien. Sa lecture est donc intéressante si on veut garder un œil vers le futur de nos communautés et de notre fonctionnement en tant que collectif dans un urbanisme souvent solitaire.
Résumé : La fabrique et la gestion des villes sont aujourd’hui confrontées, comme de nombreuses autres activités, au remplacement de décisions humaines par des décisions algorithmiques. La substitution n’est pas seulement technique et professionnelle : elle est aussi politique. Elle ne touche pas que les métiers et les emplois : elle affecte la capacité des responsables locaux et des citoyens à penser et à porter des projets de société.
Une lutte est donc engagée entre la cité politique, matrice historique des démocraties occidentales, et la ville-service numérisée proposée par les géants de l’économie numérique. Si notre société a pris conscience de l’influence croissante de ces acteurs, elle hésite entre la fascination devant les promesses d’un « salut par la technologie » et la peur d’un monde placé sous surveillance généralisée.
En prenant l’exemple des villes et de la démocratie locale, Jean Haëntjens nous explique que l’avenir n’est pas à espérer ou à redouter, mais à conquérir.