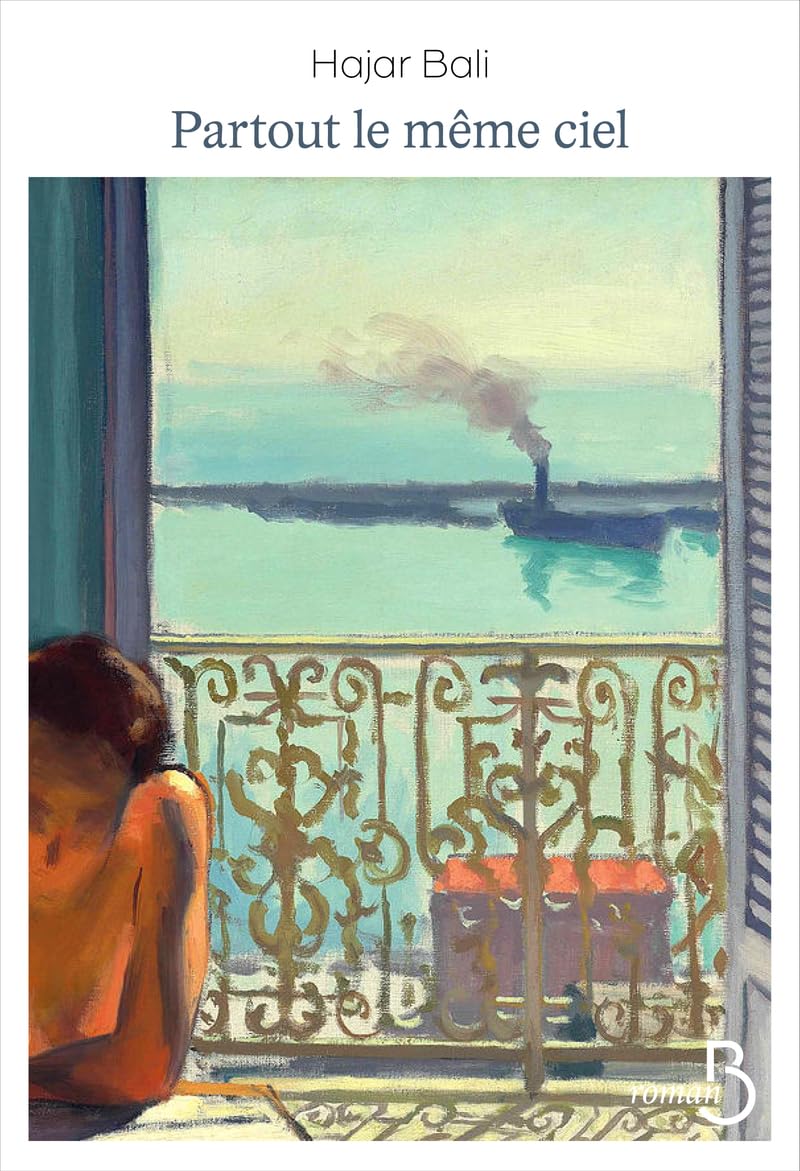Critique : Comment capter l’ambiance d’un pays par le biais de la littérature ? La question mérite réflexion ainsi qu’un débat plus long qu’une modeste chronique littéraire de quelques lignes. Néanmoins, nous ouvrons notre article par cette question car il semble que l’ambition de la romancière Hajar Bali s’oriente dans cette direction, qui s’accomplit joliment. En effet, son nouvel ouvrage, « Partout le même ciel », se révèle rapidement comme un beau roman qui, au-delà de son trio principal, capte une atmosphère ainsi que des générations qui résonnent avec l’évolution du pays.
La façon dont le roman passe de protagoniste en protagoniste se fait aisément, sans perte de repères chez le lecteur, notamment par son traitement de la langue ou simplement sa caractérisation subtile qui infuse chaque mot. Hajar Bali apporte une émotion dans la connexion qui relie ses personnages et leurs ambitions ainsi que leurs frustrations, créant une proximité sentimentale palpable. La résonnance politique qui se développe en parallèle de l’histoire d’Algérie accentue cette tangibilité d’écriture ainsi que le développement d’individus meurtris et réunis, pour le meilleur comme pour le pire.
« Partout le même ciel » s’inscrit alors comme une des lectures les plus recommandables de la rentrée littéraire, la touche émotionnelle de sa romancière s’inscrivant dans chaque mot avec une sensibilité qui frappe. Dans sa fausse modestie d’apparence, le roman cultive un portrait, aussi bien de son pays que de ses habitants, avec une verve qui fait hautement plaisir à lire et, surtout, émeut durablement.
Résumé : Algérie, années 2010.
Wafa et Adel habitent Alger. Ces deux adolescents s’aiment d’un amour farouche et ardent. Chaque jour, ils tentent d’inventer leur vie, tiraillés entre désir d’émancipation et loyautés familiales. Avec ses grandes lunettes qui lui glissent sur le nez et sa grâce un peu sauvage, Wafa semble plus solide qu’Adel, mais en eux remue, confusément, le même sentiment de révolte : ils étouffent sous le conformisme ambiant.
Un jour, ils rencontrent Slim, en révolte lui aussi, » inadapté » comme eux, ancien prof de fac, quarantenaire misanthrope. Érudit, généreux, il devient leur pygmalion, les initie à la philosophie, au cinéma, à la littérature. C’est un homme blessé pourtant, lui-même égaré, qui s’est fixé une mission, celle de sauver ces » enfants « .
Ces trois-là vont nouer une relation fusionnelle, presque mystique. Entre révolution intime et révolution politique, et si se traçait là leur chemin vers la rédemption ?